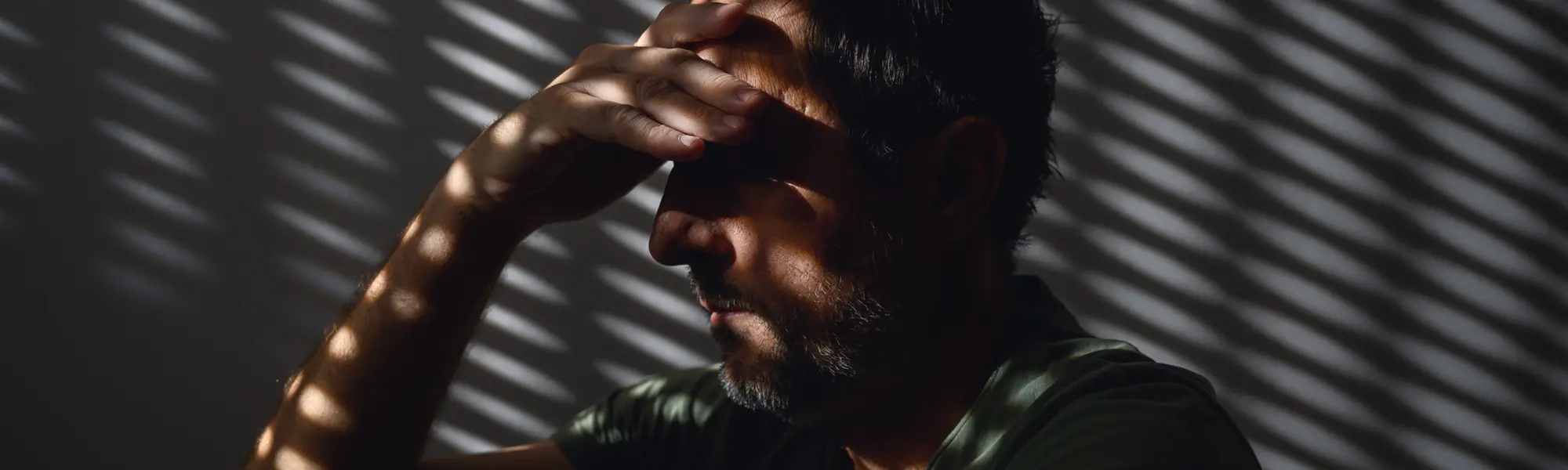Un deuil est toujours difficile à vivre, mais il peut parfois s’aggraver, et déclencher des troubles psychiques ou physiques. On parle alors de deuil pathologique. Comment le reconnaître, et que faire si l’un de vos proches, ou vous-même, êtes concerné(e) ?
Qu’appelle-t-on un « deuil pathologique » ?
Lorsqu’une personne, durant une période de deuil, développe une maladie physique ou mentale, on parle de deuil pathologique. Un phénomène qui concerne une extrême minorité de personnes endeuillées, selon le psychiatre Patrick Landman, qui s’explique par le fait que « le deuil est une période difficile pour le psychisme, c’est une période de fragilisation, qui peut être déclencheur de certaines pathologies ».
À noter : au-delà du décès d’un proche, d’autres événements peuvent plonger une personne dans le deuil, comme la perte de biens matériels, de son domicile, un divorce ou encore une perte d’autonomie (voir aussi notre article sur le deuil blanc ou celui sur le deuil anticipé).
Des maladies révélées (mais pas causées) par le deuil
Si une maladie physique ou mentale survient durant la période de deuil, on parle alors de deuil pathologique.
« Il convient de préciser que le deuil n’est pas la cause, mais le facteur déclencheur de la maladie chez un individu dont l’équilibre, bien que précaire, ne laissait pas transparaître de signes cliniques objectivables », explique le psychologue suisse Yves Philippin dans un article sur le sujet.
Il peut prendre des formes diverses : on parle par exemple de deuil maniaque, de deuil histrionique, de deuil mélancolique… avec parfois des conséquences graves pour la santé physique et mentale de la personne. Heureusement, ces deuils pathologiques concernent une extrême minorité de personnes endeuillées, souligne Patrick Landman.
Les différentes formes de deuils pathologiques
Le deuil histrionique, ou hystérique
La personne endeuillée s’efface au profit du défunt, car elle ressent un très grand sentiment d’abandon. Elle va alors se projeter sur la personne décédée, adopter ses attitudes, ses comportements… avec parfois des comportements autodestructeurs qui peuvent aller jusqu’à la tentative de suicide.
Le deuil mélancolique
Il s’agit d’une forme sévère de dépression. La personne endeuillée ressent une forte culpabilité, se dévalorise : le risque suicidaire est, là aussi, accru.
Le deuil maniaque
Il est lié à un déni persistant du décès. Il se traduit par une forme de surexcitation, une absence de souffrance affichée qui peut se transformer en agressivité, puis en mélancolie.
Le deuil traumatique
Il donne lieu à une dépression sévère et à des troubles anxieux, qui peuvent avoir des conséquences physiques à terme (risque de cancer, de maladies cardiovasculaires…). Il est souvent causé par un décès brutal, violent ou inattendu.
Le deuil post-traumatique
Il peut survenir quand le décès a eu lieu dans un contexte collectif (accident de la route, naufrage, attentat…), et d’autant plus si la personne endeuillée était ou aurait pu être présente et a survécu.
Le deuil obsessionnel
Caractérisé par des pensées répétitives, il peut s’avérer épuisant.
Le trouble du deuil prolongé et les deuils compliqués : des cas à part
Le vécu du deuil étant propre à chacun, il peut prendre différentes formes et être plus ou moins complexe sans être pathologique pour autant.
Le trouble du deuil prolongé, par exemple, fait débat. Intégré dans la dernière version du DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), le manuel américain de classification des troubles mentaux utilisé dans le monde entier, ainsi que dans la classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS depuis 2022, il n’est pourtant pas reconnu par tous les professionnels de santé mentale comme une pathologie en tant que telle.
Il ne s’agirait donc pas d’un deuil pathologique, pas plus que les deuils qualifiés de compliqués. La différence entre un deuil compliqué et un deuil pathologique est subtile :
- Dans le premier cas, le deuil aggrave une pathologie psychologique ou physique déjà existante.
- Dans le second, le deuil la déclenche.
En clair, si une dépression survient au cours du deuil, il s’agit d’un deuil pathologique.
Mais une personne dépressive avant le décès de son proche risque, elle, de vivre un deuil compliqué.
Et si la personne endeuillée traverse une phase de déprime, sans qu’une dépression ne soit diagnostiquée, il ne s’agit pas non plus d’un deuil pathologique.
Les facteurs de risque du deuil pathologique
Comme évoqué plus haut, les décès violents, inattendus sont plus susceptibles d’entraîner des deuils pathologiques.
Mais ce ne sont pas les seuls facteurs de risque : parmi les autres, on peut citer :
- la proximité avec la personne décédée (conjoint, enfant…),
- le fait d’avoir connu des deuils répétés,
- l’isolement, l’absence de support psychosocial (supports affectif, financier, relationnel),
- ou encore des rites funéraires perturbés (comme on a pu le voir durant la crise sanitaire de 2020).
Symptômes et signes d’alerte du deuil pathologique : quand faut-il s’inquiéter ?
Ils sont divers. Pour Patrick Landman, une insomnie qui persiste est particulièrement notable, car c’est un signe de souffrance psychique.
Parmi les autres signaux d’alerte, il convient de prêter attention, chez soi ou chez ses proches, à :
- des troubles de l’humeur (irritabilité, dépression persistante, mélancolie…),
- des états anxieux,
- des comportements addictifs ou à risques,
- des symptômes physiques (perte ou gain de poids, maux de tête, douleurs…),
- des troubles de la mémoire,
- un isolement social accru…
Comment gérer un deuil pathologique ?
On l’a vu, le deuil pathologique peut avoir des conséquences graves et ne doit donc pas être pris à la légère.
Il est ainsi essentiel de consulter un professionnel si des signes se manifestent. Même si le deuil pathologique n’est pas toujours évident à identifier, psychiatres ou psychologues pourront proposer des interventions en cas de difficultés particulières liées au deuil.
Selon la nature des manifestations du deuil pathologique, il pourra s’agir :
- d’un soutien psychologique,
- ou d’une psychothérapie ciblée,
- et si nécessaire de la prescription de médicaments comme des régulateurs de l’humeur (thymorégulateurs), des antidépresseurs ou des anxiolytiques.