Avec l’âge, de plus en plus de personnes se plaignent de troubles de la mémoire. Mais à quoi sont-ils dus ? Quels bons gestes adopter pour s’en prémunir, ou du moins les compenser ? Pour mieux comprendre, plongée dans la mémoire et son évolution avec l’âge.
Pourquoi la mémoire diminue avec l'âge ?
Les différentes types de mémoire et leur évolution
La mémoire est la capacité à enregistrer des informations, à les conserver et à les restituer.
Mais en réalité, il n’existe pas une, mais des mémoires, dont l’utilité et le fonctionnement diffèrent. Tour d’horizon.
Mémoire à court terme vs mémoire à long terme
Il faut tout d’abord distinguer la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
La première, comme son nom l’indique, concerne les événements récents. C’est la mémorisation d'une information de quelques secondes à quelques minutes. On l’appelle également la mémoire de travail.
Une fois la tâche accomplie, plus besoin de se souvenir de l’information : elle est utile, par exemple, quand il s’agit de mémoriser une liste de courses, ou de suivre une recette de cuisine.
Elle peut être visuelle, mais aussi auditive : qui n’a pas répété à haute voix un numéro de téléphone avant de le composer ?
La mémoire à court terme est donc sollicitée dans de nombreuses tâches quotidiennes. Parfois, les informations enregistrées sont effacées immédiatement, mais selon les besoins, elles peuvent aussi être transférées dans la mémoire à long terme.
La mémoire à long terme vise en effet à stocker des informations durablement. Mais elle peut prendre plusieurs formes.
Mémoires épisodique, sémantique et procédurale
Et oui, il n’y a pas non plus une, mais des mémoires à long terme.
La mémoire épisodique est la mémoire en relation avec le temps, le lieu, des évènements marquants (jour de son mariage, de la naissance des enfants, etc.), des événements qui nous sont personnels. C’est pourquoi, on parle aussi de mémoire autobiographique.
Elle est intimement liée à la mémoire sémantique, c’est-à-dire la mémoire du savoir et de la connaissance. Elle concerne les acquis scolaires ou professionnels, les connaissances sur les lieux ou les personnes…
La mémoire procédurale, enfin, est aussi appelée mémoire des automatismes. C’est celle qui est à l’œuvre pour faire du vélo ou tricoter par exemple. Il s’agit, en somme, de la mémoire du savoir-faire et de l’acquisition des habilités. Elle est activée de manière inconsciente : pas besoin de réfléchir, de décomposer le mouvement pour marcher, par exemple.
A noter aussi, l’existence d’une autre forme de mémoire à long terme, la mémoire perceptive. Liée aux sens, elle permet, par exemple, de se souvenir d’un visage, d’une voix, d’un itinéraire grâce à des repères visuels...
Enfin, les chercheurs s’intéressent de plus en plus à une autre forme de mémoire, la mémoire émotionnelle, qui enregistre les émotions associées à une expérience. C’est elle qui est à l’œuvre, par exemple, dans le stress post-traumatique, mais le plus souvent, elle se concentre sur les émotions positives.
Audit SEO Noiise;
| Type de mémoire | Définition | Fonction principale | Exemples concrets | Caractéristiques spécifiques |
| Mémoire épisodique | Mémoire des événements personnels situés dans le temps et l’espace | Se souvenir d’expériences vécues | Mariage, naissance d’un enfant, voyage marquant | Aussi appelée mémoire autobiographique |
| Mémoire sémantique | Mémoire des connaissances générales et du savoir | Stocker des faits, concepts, règles | Capitales des pays, vocabulaire, théories scientifiques | Intimement liée à la mémoire épisodique |
| Mémoire procédurale | Mémoire des automatismes et des savoir- faire | Réaliser des actions sans réflexion consciente | Faire du vélo, conduire, jouer d’un instrument | Fonctionne de manière inconsciente |
| Mémoire perceptive | Mémoire liée aux perceptions sensorielles | Reconnaître les visages, sons, lieux | Se souvenir d’un visage, d’une voix familière, d’un itinéraire | Fondée sur les repères sensoriels |
| Mémoire émotionnelle | Mémoire des émotions associées à une expérience | Enregistrer et réactiver des émotions liées à un souvenir | Peur après un accident, joie en retrouvant un lieu aimé | Joue un rôle clé dans le stress post-traumatique |
L'impact du vieillissement sur la mémoire
Comme tous les organes, le cerveau vieillit, et ce dès l’âge de 45 ans, montre une étude publiée en 2012. Avec des conséquences sur l’ensemble des fonctions cognitives : capacités de raisonnement, fluidité du langage… et bien sûr, mémoire.
Certaines mémoires en pâtissent plus que d’autres, notamment la mémoire à court terme. D’autres restent fonctionnelles jusqu’à la fin de la vie, comme la mémoire émotionnelle.
Causes du déclin de la mémoire chez les seniors
Dès 45 ans, donc, notre mémoire commencer à décliner, plus ou moins selon les individus.
Vieillissement naturel du cerveau
Avec l’âge, le cerveau perd des cellules nerveuses (les neurones) : le vieillissement altère la capacité des cellules à se multiplier et à se réparer, et la taille du cerveau diminue en conséquence. Il perd également des connexions neuronales.
Contrairement aux idées reçues, le cerveau continue de produire des neurones jusqu’à un âge avancé : 90 ans environ.
De plus, pour compenser ces altérations, il est capable de « recruter » de nouvelles zones, quand une partie du cerveau jusqu’alors utilisée pour accomplir une tâche devient défaillante. Et ceci, grâce à une capacité particulière, la plasticité, qui permet de créer de nouvelles connexions entre les neurones, jusqu’à la fin de la vie.
Facteurs de risque (stress, isolement, alimentation, maladies neurodégénératives)
Nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement cérébral. Si toutes les raisons expliquant ces différences ne sont pas encore connues, les chercheurs ont identifié 14 facteurs qui augmentent le risque de déclin cognitif :
- une consommation excessive d’alcool,
- un traumatisme crânien,
- la pollution de l'air,
- un faible niveau d’éducation,
- l’hypertension, surtout à partir de la quarantaine,
- une déficience auditive non traitée (appareillage),
- le tabagisme,
- l’obésité,
- la dépression (qui peut aussi être un symptôme précoce de la maladie d’Alzheimer),
- la sédentarité,
- le diabète, de type 2 notamment,
- l’isolement social,
- l’hypercholestérolémie,
- la perte de vision.
Différencier pertes de mémoire normales et pathologiques
Les maladies neurodégénératives, Alzheimer en particulier, font peur, et il est légitime de s’inquiéter quand notre mémoire nous joue des tours après un certain âge.
Cependant, certains oublis sont normaux : ne plus se rappeler où l’on a posé ses clefs ou manquer un rendez-vous ne doit pas vous alarmer.
En revanche, France Alzheimer recense 10 signes qui doivent inciter à consulter, s’ils se répètent ou se cumulent.
Parmi eux, les oublis d’événements récents (mémoire immédiate) ou le fait de poser incessamment la même question (oubli de la réponse tout juste donnée), les difficultés pour accomplir les tâches de la vie quotidienne comme conduire ou s’habiller (mémoire procédurale), ou encore la désorientation dans le temps et dans l’espace, en particulier si la personne se perd dans un endroit familier (mémoire perceptive).
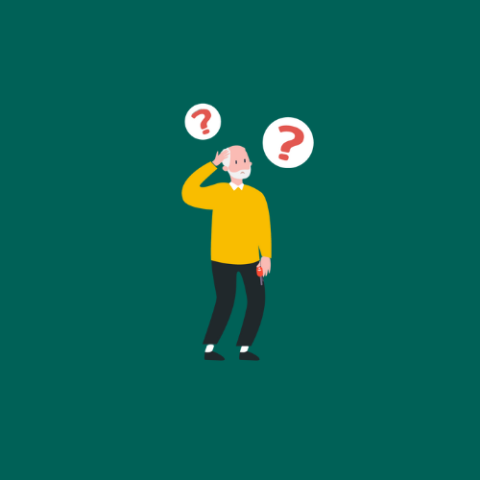
Maladies neurodégénératives
Alzheimer, Parkinson, maladie de Charcot… Tous nos conseils pour ceux qui aident un proche malade.
Le + : Un guide pratique offert !
Comment améliorer et préserver sa mémoire après 60 ans ?
Les meilleures habitudes à adopter
Les facteurs de risque identifiés par les chercheurs sont évitables pour la plupart : changer certaines habitudes permet donc de faire du bien à son cerveau !
Alimentation et mémoire : les nutriments essentiels
L’obésité, l’hypertension, le diabète de type 2 et le surplus de cholestérol figurant parmi les facteurs de risques, il est primordial d’adopter une alimentation équilibrée pour préserver son cerveau et sa mémoire.
Par ailleurs, certains nutriments sont bénéfiques au fonctionnement cérébral et à la mémoire, en particulier les omégas 3 et les polyphénols (antioxydants).
Les premiers se trouvent en quantité dans certains végétaux (noix, huile de colza, huile de lin) et dans les poissons gras comme le thon, le saumon, le maquereau, l’huile de foie de morue…
Les seconds sont très présents dans les fruits, notamment les fruits rouges, les agrumes et les pommes, mais aussi dans le thé, le café et le cacao.
Bon à savoir :
Les fruits, légumes et produits céréaliers bio sont 18 à 69 % plus riches en polyphénols que les aliments issus de l’agriculture conventionnelle, a montré une étude en 2014.
En revanche, les aliments riches en graisses saturées et en sucres sont à proscrire, car ils perturbent certaines capacités de la mémoire et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires.
L’importance du sommeil et de la relaxation
Dès la naissance, sommeil et mémoire entretiennent des liens étroits : un sommeil de qualité est essentiel à la mémorisation par exemple.
En vieillissant, la qualité et la durée du sommeil se modifient, et les chercheurs pensent aujourd’hui que cette transformation est liée à l’évolution de la mémoire due à l’âge. Ils ont notamment identifié une zone du cerveau qui serait responsable de la réduction du temps de sommeil, avec des répercussions sur la consolidation des mémoires sémantique et épisodique.
Les troubles du sommeil pourraient aussi aggraver les dégénérescences cérébrales de la maladie d’Alzheimer, et troubles de la mémoire associés.
Le stress peut également rendre la mémorisation défaillante. Il peut même effacer plus ou moins certaines parties de la mémoire, affirme le professeur Louis F. Perrin dans son ouvrage Le psychisme, le stress et l’immunité.
Les techniques de relaxation (médiation, exercices de respiration, massages, yoga…) peuvent aider à lutter contre le stress.
Exercice physique et santé cognitive
La sédentarité étant l’ennemie de la santé cognitive, pratiquer une activité physique régulièrement sera forcément bénéfique.
D’abord, parce qu’elle contribue à maintenir le cerveau « jeune », explique la Fondation pour la recherche sur le cerveau. Ensuite, parce qu’elle diminue le risque de survenue de maladies neurodégénératives, retarde leur apparition et leur développement, le cas échéant, à condition d’être pratiquée au moins une heure par jour.
A noter : toute forme d’activité physique, même de simples promenades, est bonne à prendre. Cependant, les effets seront différents selon l’intensité de la pratique. Mais dans tous les cas, l’exercice physique améliore plus la mémoire que l’inaction, souligne l’université de Genève.
De plus, l’activité physique permet de gérer le stress et réduit le risque d’autres pathologies comme les maladies cardio-vasculaires, le diabète, elles-mêmes néfastes pour la mémoire : un vrai cercle vertueux.
Bonus : un quiz pour faire le point sur ses habitudes et leur impact sur notre cerveau
Plus d’idées concrètes pour prendre soin de son cerveau et stimuler sa mémoire > lien vers le deuxième article
Pour aller plus loin : ressources et informations complémentaires










